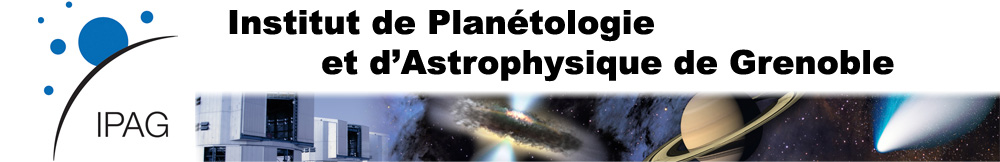Origins and evolution of nitrogen on the planetesimals of the solar system : study of the nature and isotopic composition of nitrogen-bearing phases in carbonaceous chondrites
Origines et évolutions de l’azote sur les planétésimaux du système solaire : étude de la nature et de la composition isotopique des phases azotées des chondrites carbonées
Résumé
The incorporation and evolution of nitrogen (N) in the early solar system, as well as on the primitive earth, are still not completely understood. Questions remain concerning the nature and distribution of N-bearing phases that were present in the protoplanetary disk and are now present in small bodies, remnants of the protoplanetary disk, and by extend in cosmomaterials. At this time in the literature, it is commonly assumed that in carbonaceous chondrites and comets, most of the total nitrogen is present in the refractory organic material. However, nitrogen in the form of ammonium (NH4+) has been identified by spectroscopy on various objects and recently has been quantified in the Ryugu samples returned on Earth by the Hayabusa2 mission. Because carbonaceous chondrites are the most volatile-rich of primitive meteorites, studying the nature and isotopic compositions of the N-bearing phases present in these meteorites are key data for exploring the origin and evolution of nitrogen in the young solar system. What are the N-bearing phases present in carbonaceous chondrites? How is the nitrogen distributed between NH4+, soluble and insoluble organic matter? Were these N-bearing phases incorporated at the same location and/or time in the parent bodies of carbonaceous chondrites?To answer these questions, the aim of my doctoral work was to develop a protocol to analyse the nitrogen abundances and isotopic compositions of the bulk, insoluble organic matter (IOM) and NH4+ N-bearing phases present in carbonaceous chondrites.In the studied chondrites (3 CI, 2 C2-ung, 7 CM, 6 CR), N is mainly distributed between two fractions: IOM (42 % of the total N in average) and an unanalysed N-bearing fraction, probably acid-soluble N and/or lost IOM (43 % of the total N in average). CI chondrites appear to be the richest in water-soluble NH4+, with about 1/4 of their total nitrogen being in this phase. The extracted ammonium has a d15N of +72 ± 9 ‰ in Orgueil and between +49 ‰ and +237 ‰ in Ivuna and Alais, confirming its extraterrestrial origin. The d15N of the extracted NH4+ in CMs and CRs could not be precisely constrained but might range between -4 ‰ and +184 ‰ in CMs and +121 ‰ and +1000 ‰ in CRs. The water-soluble NH4+ extracted from CIs, C2-ung, CMs and CRs could be under the form of salts and/or present in organic and/or inorganic minerals as phyllosilicates. The water-soluble NH4+ could potentially originate from the decomposition of IOM and/or amino acids and/or could be the tracer of NH3 ices and hydrates accreted on the parent bodies of carbonaceous chondrites.Despite the experimental limitations, it would appear that the CM Winchcombe and the CI Orgueil have similar d15NH4+ values and matrix and phyllosilicate abundances. This suggests that the parent bodies of these meteorites may have incorporated their NH4+ from the same reservoir in the solar system, and/or that CI material was mixed with CM material during the evolution of the solar system. CRs appear to be distinguished from CIs, C2-ung and CMs, notably by an enrichment of the studied N-bearing phases in 15N. The N-isotopic compositions of CRs are close to those of outer solar system objects, suggesting a potential cometary origin for these meteorites. I proposed new experimental developments that will enable us to refine this research and provide new insights into the incorporation and evolution of nitrogen in the solar system.
L'incorporation et l'évolution de l'azote (N) dans le système solaire jeune, ainsi que sur la Terre primitive, demeurent des processus encore mal compris. Des questions persistent quant à la nature et à la distribution des phases azotées qui étaient présentes dans le disque protoplanétaire, et qui sont aujourd’hui présentes sur les petits corps, vestiges du disque protoplanétaire, et par extension, dans les cosmomatériaux. Actuellement dans la littérature, il est communément admis que dans les chondrites carbonées et les comètes, la majorité de l'azote se trouve sous forme de matière organique réfractaire. Cependant, de l'azote sous forme d'ammonium (NH4+) a été identifié par spectroscopie sur divers objets et récemment quantifié dans les échantillons de Ryugu rapportés sur Terre par la mission Hayabusa2. Les chondrites carbonées étant les météorites primitives les plus riches en matières volatiles, la nature et la composition isotopique de leurs phases azotées sont des données clés pour étudier l'origine et l'évolution de l'azote dans le système solaire jeune. Quelles sont les phases azotées présentes dans les chondrites carbonées ? Comment l'azote est-il réparti entre NH4+, la matière organique soluble et insoluble ? Ces phases azotées ont-elles été formées et/ou incorporées au même endroit dans le disque protoplanétaire et/ou au même moment dans les corps parents des chondrites carbonées ?Pour répondre à ces questions, l’objectif de mes travaux de thèse était de développer un protocole expérimental permettant l’analyse des abondances et compositions isotopiques de l’azote du bulk, de la matière organiques insoluble (IOM) et de NH4+ de chondrites carbonées.Dans les chondrites étudiées (3 CI, 2 C2-ung, 7 CM, 6 CR), l’azote total est réparti principalement entre deux fractions : l’IOM (42 % de l’azote total en moyenne) et une fraction d’azote non-analysée, probablement composée d’azote soluble dans les acides et/ou d’IOM perdue (43 % de l’azote total en moyenne). Les CIs semblent être les chondrites les plus riches en NH4+, avec 1/4 de leur azote total présent dans cette phase. Le NH4+ extrait a un d15N de +72 ± 9 ‰ dans Orgueil et entre +49 ‰ et +237 ‰ dans Ivuna and Alais, confirmant son origine extraterrestre. Le d15NH4+ des CMs et CRs n’a pas pu être contraint avec précision et pourrait être compris entre -4 ‰ et +184 ‰ pour les CMs et entre +121 ‰ et +1000 ‰ pour les CRs. Le NH4+ extrait des CIs, C2-ung, CMs et CRs pourrait être présent sous formes de sels et/ou dans des sites minéraux organiques et/ou inorganiques. Il pourrait provenir de la décomposition d’IOM et/ou d’acides aminés et/ou pourrait être le traceur des glaces et hydrates de NH3 accrétés sur les corps parents des chondrites carbonées.Malgré les limitations expérimentales, il semblerait que la CM Winchcombe et la CI Orgueil possèdent un d15NH4+ et des abondances en matrice et phyllosilicates similaires. Cela suggère que les corps parents de ces météorites ont pu incorporer leur ammonium d’un même réservoir dans le système solaire, et/ou que de la matière CI ait été mélangée avec de la matière CM lors de l’évolution du système solaire. Les CRs semblent se distinguer des CIs, C2-ung et CMs, notamment par un enrichissement en 15N des phases azotées étudiées. Les compositions isotopiques de l’azote des CRs se rapprochent de celles des objets du système solaire externe, suggérant une potentielle origine cométaire de ces météorites. J’ai identifié de nouveaux développements expérimentaux qui permettront d’affiner ces recherches et d’apporter de nouveaux éléments de réponse sur les processus d’incorporation et d’évolution de l’azote dans le système solaire.
| Origine | Version validée par le jury (STAR) |
|---|